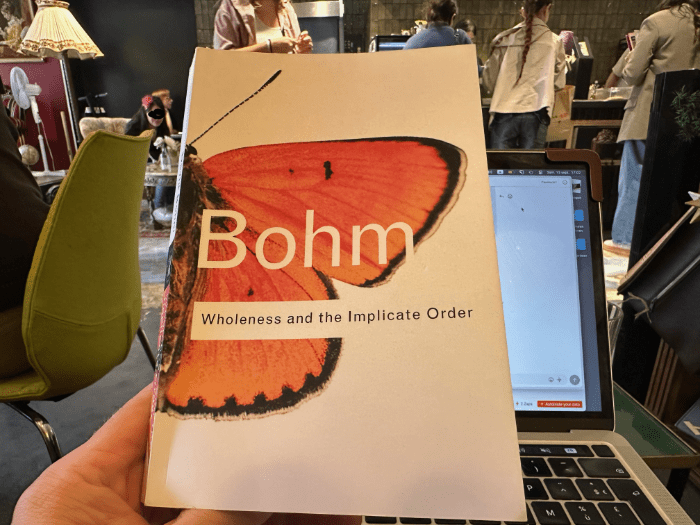
Je suis en train de lire un livre qui me met en joie : Wholeness and the Implicate Order, de David Bohm. J’y découvre des points de vue qui font le bonheur de tout esprit curieux, mais encore plus des gens qui font du Feldenkrais. En effet, il y est question de la façon dont nos sociétés et nos idées ont eu tendance à défendre que le monde est une collection de petits morceaux qui s’entrechoquent, en perdant de vue le global et des principes organisateurs à grande échelle.
Et s’il y a bien une chose qu’on aime en Feldenkrais, c’est de retrouver comment ce global fonctionne de manière harmonieuse.
Parmi les notions développées, on y parle du mot « rationalité », qui vient de ratio, donc de proportion. On le trouve encore ici ou là dans la langue, quand on évoque le sens de la mesure. En effet, ce sens initial parlait d’harmonie interne, de justes proportions, de correspondances qui distinguaient le brutal du gracieux et vivant.
Comment le mot a-t-il évolué ? Mmmmh, en général, on ne mesure plus qu’avec un mètre, c’est une donnée externe, objective, absolue, ne laissant plus de place pour qu’une personne juge de la mesure avec sa sensibilité, parce qu’elle sent une harmonie interne, ou au contraire une discordance. Le nombre d’or conduit à des rectangles jugés beaux par celles et ceux qui regardent, pas parce qu’il vaut environ 1,618 033 988 749 894…
Voici donc une raison supplémentaire de faire du Feldenkrais : retrouver le côté esthétique (donc de sensation) de la mesure, et nourrir la juste mesure au travers de nos séances. Rendez-vous lors de nos prochaines leçons pour muscler notre sens de la mesure.
Voici l’extrait traduit, suivi de l’original :
Chaque fois que nous trouvons une raison théorique à quelque chose, nous mettons en œuvre cette notion de ratio, dans le sens suivant : nous sous-entendons que lorsque nous percevons des relations entre divers aspects dans notre idée, alors ils sont ainsi liés dans la chose dont traite cette idée. La raison, ou ratio, essentielle d’une chose est alors la totalité des proportions internes de sa structure, ainsi que du processus par lequel elle se forme, se maintient et, finalement, se dissout. Dans cette perspective, comprendre une telle ratio, c’est comprendre « l’être le plus intime » de cette chose.
Il s’ensuit que la mesure est une forme d’aperçu de l’essence de toute chose, et que la perception de l’homme, en suivant les voies indiquées par un tel aperçu, sera claire et produira, de ce fait, une action généralement ordonnée et une vie harmonieuse. À cet égard, il est utile de rappeler les conceptions grecques antiques de la mesure en musique et dans les arts visuels. Ces conceptions insistaient sur le fait qu’une saisie de la mesure était la clé de la compréhension de l’harmonie en musique (par exemple, la mesure comme rythme, la juste proportion dans l’intensité du son, la juste proportion dans la tonalité, etc.). De même, dans les arts visuels, la juste mesure était tenue pour essentielle à l’harmonie et à la beauté d’ensemble (par exemple, songez au « nombre d’or »). Tout cela montre à quel point la notion de mesure allait bien au-delà de la comparaison à un étalon externe, pour renvoyer à une sorte de ratio ou de proportion intérieure, universelle, perçue à la fois par les sens et par l’esprit.
Bien entendu, avec le temps, cette notion de mesure commença peu à peu à changer, à perdre de sa subtilité et à devenir relativement grossière et mécanique. Sans doute parce que la notion de mesure chez l’homme devenait de plus en plus routinière et habituelle, tant dans sa manifestation extérieure — des mesurages (NdT: ce n’est pas le plus joli mot, mais c’est l’action technique de mesurer) rapportés à une unité externe — que dans sa signification intérieure en tant que proportion universelle pertinente pour la santé physique, l’ordre social et l’harmonie mentale. Les hommes commencèrent à apprendre de telles notions de mesure de manière mécanique, en se conformant aux enseignements de leurs aînés ou de leurs maîtres, et non de façon créative, par un sentiment intérieur et une compréhension du sens plus profond de la ratio ou de la proportion qu’ils apprenaient. Ainsi, la mesure en vint progressivement à être enseignée comme une sorte de règle (NdT: tiens, tiens, une règle et une mesure ?) à imposer de l’extérieur à l’être humain, lequel imposait à son tour la mesure correspondante — physiquement, socialement et mentalement — dans tous les contextes où il agissait. De ce fait, les conceptions dominantes de la mesure ne furent plus considérées comme des formes de compréhension intime. Elles apparurent au contraire comme des « vérités absolues sur la réalité telle qu’elle est », que les hommes semblaient avoir toujours connues, et dont l’origine était souvent expliquée mythologiquement comme des injonctions contraignantes des dieux, qu’il serait à la fois dangereux et impie de remettre en question. La réflexion sur la mesure tendit ainsi à tomber principalement dans le domaine de l’habitude inconsciente et, par conséquent, les formes induites dans la perception par cette pensée furent désormais tenues pour des réalités objectives directement observées, essentiellement indépendantes de la manière dont on les pensait.
L’original en anglais
Whenever we find a theoretical reason for something, we are exemplifying this notion of ratio, in the sense of implying that as the various aspects are related in our idea, so they are related in the thing that the idea is about. The essential reason or ratio of a thing is then the totality of inner proportions in its structure, and in the process in which it forms, maintains itself, and ultimately dissolves. In this view, to understand such ratio is to understand the ‘innermost being’ of that thing.
It is thus implied that measure is a form of insight into the essence of everything, and that man’s perception, following on ways indicated by such insight, will be clear and will thus bring about generally orderly action and harmonious living. In this connection, it is useful to call to mind Ancient Greek notions of measure in music and in the visual arts. These notions emphasized that a grasp of measure was a key to the understanding of harmony in music (e.g, measure as rhythm, right proportion in intensity of sound, right proportion in tonality, etc.). Likewise, in the visual arts, right measure was seen as essential to overall harmony and beauty (e.g., consider the ‘Golden Mean’).
All of this indicates how far the notion of measure went beyond that of comparison with an external standard, to point to a universal sort of inner ratio or proportion, perceived both through the senses and through the mind.
Of course, as time went on, this notion of measure gradually began to change, to lose its subtlety and to become relatively gross and mechanical. Probably this was because man’s notion of measure became more and more routinized and habitual, both with regard to its outward display in measurements relative to an external unit and to its inner significance as universal ratio relevant to physical health, social order, and mental harmony. Men began to learn such notions of measure mechanically, by conforming to the teachings of their elders or their masters, and not creatively through an inner feeling and understanding of the deeper meaning of the ratio or proportion which they were learning. So measure gradually came to be taught as a sort of rule that was to be imposed from outside on the human being, who in turn imposed the corresponding measure physically, socially and mentally, in every context in which he was working. As a result, the prevailing notions of measure were no longer seen as forms of insight. Rather, they appeared to be ‘absolute truths about reality as it is’, which men seemed always to have known,and whose origin was often explained mythologically as binding injunctions of the Gods, which it would be both dangerous and wicked to question. Thought about measure thus tended to fall mainly into the domain of unconscious habit and, as a result, the forms induced in perception by this thought were now seen as directly observed objective realities, which were essentially independent of how they were thought about.
Photo de Content Pixie sur Unsplash






