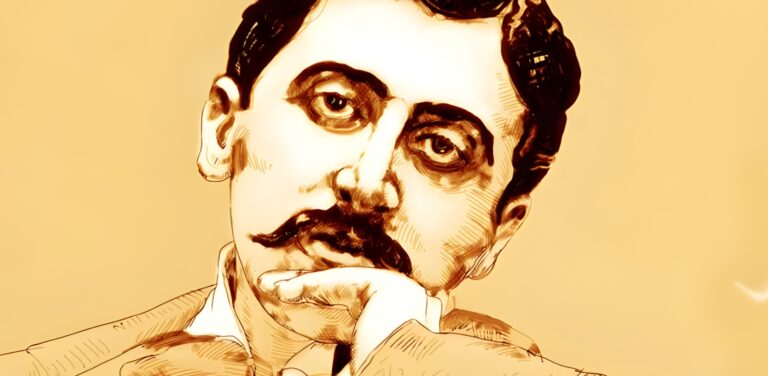Assis dans un café, je vois une jeune femme devant son ordinateur passer un long moment pour sélectionner la totalité d’un texte… et je me demande pourquoi elle n’utilise la commande faite pour ça (CTRL-A ou CMD-A évidemment).
S’ensuit un petit théâtre mental où j’imagine ce qui se passerait si quelqu’un lui montrait la manœuvre. J’y ai craint qu’elle ne rejette cette option, trop occupée qu’elle était à tout vouloir faire vite, sans jamais ralentir pour se demander si elle pouvait le faire mieux, plus simplement, mais c’est moins familier au début. L’enseignant de maths que je suis le remarque chez ses étudiants : ils sont maintenant très nombreux à chercher en permanence la solution de facilité, comme s’il était urgent de répondre à la question la plus étroite possible et d’éviter d’assimiler une notion ou une compétence nouvelle.
En plus de l’accélération qui encourage à ne pas prendre le temps, par définition, on a cet effet puissant de la familiarité : entre une méthode familière et une méthode nouvelle, il y a une prime à ce qui est connu. Pas facile de prendre le temps de ralentir, remarquer, évaluer, décider ce qui fonctionne, et peut-être adopter une nouvelle façon de faire ! C’est d’autant moins facile qu’on ne peut pas imaginer ce qu’on ne connaît pas, pourquoi passer du temps avec ce morceau d’inconnu alors que nos méthodes habituelles ont fait leurs preuves ?
La métaphore avec la pratique de Feldenkrais étant évidente, me voilà sur mon clavier pour (vite) vous écrire ces lignes. Dans un monde qui s’agite de plus en plus vite en tous sens — voir le très bon livre de Hartmut Rosa sur l’accélération — est-ce étrange de ralentir pour vérifier ce que l’on pourrait faire mieux et se fatiguer moins ? Est-ce un effort que de dire « pause » et est-ce pénible de faire quelque chose de lent ? Je prétends que nous pouvons trouver cela facile, si nous choisissons de laisser les agités entre eux 😇